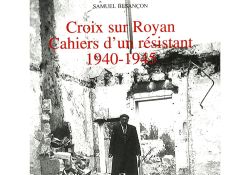Le 5 janvier 1945, le Pasteur Samuel Besançon était resté à Royan alors que sa famille avait été évacuée. Il a vécu cette nuit tragique et, comme tous les Royannais, en est resté profondément bouleversé. En 1945 et pendant de longues années, quand deux rescapés se rencontraient, ils évoquaient le bombardement. Il a livré son témoignage dans un livre remarquable, Croix sur Royan, Éditions Croît Vif, Éditions Bonne Anse 2000.
Étendu contre une murette
Le bruit des moteurs s'accroissait fortement et devenait insupportable ; puis la lumière inonda la chambre et aussitôt le fracas de la DCA s'établit. Enfin, complètement réveillé et un peu inquiet, je bondis à la fenêtre et c'est un spectacle tout à fait inédit que j'eus sous les yeux. À travers les faisceaux blafards et entrecroisés des projecteurs multiplement émaillés par les gros flocons noirs ou jaunâtre des obus de la DCA, descendaient lentement des parachutes soutenant de grosses fusées éclairantes, quelques-unes d'un rouge vif, la plupart d'un blanc éblouissant. L'on y voyait comme au mois d'août à midi ; les maisons, les arbres apparaissaient avec tous leurs détails, donnant quand même une impression bizarre sous ce ciel lourd de fumées et de lumières artificielles, en pleine nuit d'hiver, à quatre heures dix du matin. En quelques minutes, un cercle éblouissant de lumières et de feu encadrait la ville en sommeil ou déjà en réveil. Aucun doute n'était plus permis : ce n'était pas le paisible et ronronnant avion postal allemand. Il ne faisait pas tant de cérémonies ni autant de dépense et, quand il venait, les lumières montaient du sol et ne descendaient pas des cieux. Les deux avions signaleurs avaient terminé leur tâche qui était de dessiner un "panier lumineux" au-dessus de Royan. C'est ainsi que cela s'appelle en langage aéronautique. Le grand vent du nord-est a pu déporter les parachutes vers le sud-ouest, ce qui explique la situation privilégiée de Pontaillac (ou résidaient le quartier général et les principaux services, sauf la Gestapo) lors du bombardement subséquent. La DCA ralentit un peu son tir car les avions signaleurs, missions terminée, s'éloignaient en direction du sud-ouest, semble-t-il.
Mais un bruit lourd, terrifiant, emplissait, déjà le ciel, augmentant sans cesse d'intensité ; c'était d'une puissance sonore cent fois plus forte que les rugissements de l'océan déchaîné ou que mille trains de marchandises roulant ensemble sur des voies parallèles.
Plus de doute permis ! Notre heure avait sonné au cadran de la guerre ! "Le Boche" allait avoir son dû et nous devions encaisser un bombardement de première classe.
Avec la plus extrême célérité (et l'on va vite en ces moments-là), dans la chambre éclairée comme en plein jour, je me vêtis du mieux possible, malheureusement sans songer aux bretelles qui m'ont bien manqué par la suite, ainsi que les souliers qui se trouvaient en bas. Dévaler les escaliers, ouvrir la porte de la cuisine en force et s'affaler au bout du jardin, étendu contre une murette de trente centimètres de hauteur, le béret enfoncé sur la tête et le col de la canadienne relevé sur les oreilles, tout cela ne m'a pas pris une minute et il était temps car, le vacarme assourdissant des six cents ou sept cents moteurs vrombissant était déjà troué par les déchirantes ruptures de son que sont les explosions des bombes. Je n'ai pas la prétention littéraire d'un Flaubert qui ne concevait pas son oeuvre Salammbô sans la description du siège de Carthage ; il avoua lui-même n'y avoir pas réussi, mais j'essaierais de donner par écrit une description du bombardement, conforme à mes sensations et à mes souvenirs. Il est difficile d'ordonner tout cela, car tout y est confus et si rapide que l'on a même plus le temps de réfléchir : on réalise sur l'instant.
C'est d'ailleurs l'avis de ceux qui ont rédigé des articles sur cette nuit sinistre : maître Dufour et monsieur Tiple des PTT auxquels j'emprunterais quelques lignes et quelques renseignements, puisqu'ils habitaient assez loin de nous, dans des quartiers absolument dévastés, pour la raison majeure que les maisons se touchaient et qu'à part quelques courettes, il n'y avait pas de grands espaces libres comme nos jardins ou petits parcs de l'avenue de Pontaillac. Il y a quatre façons de subir un bombardement aérien ; la meilleure est d'avoir à sa disposition un abri aménagé très profondément sous terre : carrières de pierres de taille, galeries de métro, caves dans le roc, ou encore blockhaus en béton armé. Les Royannais n'avaient rien de tout cela, sauf peut-être les prisonniers de Deli qui furent convoyés dans les abris hypogés du bois, à Pontaillac.
La seconde ne nécessite aucun souci, aucune dépense : c'est le plein air pour ceux qui disposent d'espace libre, cultivé ou non. Le mieux alors est de se coucher à toucher une petite murette pour arrêter le souffle de la bombe (au moins d'un côté). C'est une question de chance : ce n'est pas gros, un corps d'homme sur le sol, ni très proéminent mais si le projectile tombe droit au-dessus du sol, ou juste à proximité, du côté non abrité, c'est bien sûr, la catastrophe. Il m'apparaît, bien à retardement certes, que le meilleur procédé serait de s'allonger dans une petite tranchée de deux mètres de longueur, cinquante centimètres de profondeur. Comme cela, l'on évite à coup sûr le souffle de la bombe qui fait éclater les poumons, le foie, le cœur et les vaisseaux sanguins à l'intérieur du corps et, sans aucune blessure apparente, provoque l'arrêt instantané de la vie. On échappe aussi à l'étouffement provoqué dans les tranchées profondes par le rapprochement des parois (l'exemple le plus célèbre est celui de la tranchée des baïonnettes à Douaumont-Verdun où toute une section fut asphyxiée baïonnette au canon, juste avant l'attaque ; seules les baïonnettes sortaient du sol). Et si l'on est bousculé et mi-enseveli par une explosion très proche, on peut plus facilement ressurgir à la lumière sans avoir un trop lourd fardeau de terre à secouer.
Reste le cas du coup direct qui peut toujours advenir, et alors tout le monde a compris la suite de l'histoire : un de plus de soufflé dans l'éternité et n'en parlons plus ! La troisième manière de se croire en sécurité est de se réfugier dans l'abri familial si fortement recommandé par la défense passive et par les Allemands. S'enterrer dans une petite tranchée étayée de rondins souvent minuscules et recouverts de trente centimètres de terre m'a toujours répugné. Autant tenter sa chance à l'air libre ; l'on a toujours le temps de demeurer sous terre. Combien sont morts, étouffés dans ces abris illusoires. Il faut marcher avec son temps, et ce qui était une projection suffisante contre les boulets de Napoléon Ier et les mitrailleuses de 1918 ne représente rien de sûr sous des bombes de cinq cents kilos et plus.
Restent enfin les caves ; c'est la plus mauvaise solution car à l'action directe de la bombe viennent s'ajouter ses effets indirects, c'est-à-dire : les décombres dont le poids écrase les corps, les risques d'incendie et la noyade par rupture des conduites d'eau. La plupart de ceux qui ont trouvé la mort dans le centre même de Royan ont péri ainsi mais ils ne pouvaient faire mieux. L'on frémit à la pensée de ce qui s'est passé dans les grands centres urbains.
N'ayant pas la possibilité d'accéder à un blockhaus allemand, d'abord parce que tout ce qui est allemand me répugne et ensuite parce que je n'avais pas le temps de tirer des plans sur la comète, j'ai utilisé, à l'occasion de la première vague, le procédé du plein air. Ce n'est pas brillant mais on peut "jouir du spectacle". Il ne fut certes pas gratuit puisqu'il nous a tout pris (sauf les quelques hardes qui me couvraient le corps) mais au moins, ce spectacle je l'ai contemplé aux premières loges et je peux le décrire à peu près. Les premières bombes tombèrent vers le fort du Chay et instantanément la villa Lucie fut un amas de ruines et de flammes. Première pensée : "C'est au fort qu'ils en ont mais attention à nous car nous sommes sous la trajectoire." En effet, il me semblait, dans l'infernal concert toujours brillamment éclairé au magnésium et d'après le bruit des explosions, que Royan subissait une attaque massive, caractéristique et baptisée "attaque de port" sur trois axes principaux parallèles, à peu près nord-sud soit : Bernon - Chay (le nôtre), Saint-Pierre - Port, Belmont - Gare.
Puis les coups se multiplièrent et se rapprochèrent dangereusement. Nul de ceux qui ont vécu ce premier intermède en plein air, ne peut oublier les détails sonores de cette rhapsodie apocalyptique. L'énorme, ou plutôt "l'hénaurme" (comme eût dit Flaubert) vrombissement collectif des trois cents ou trois cent cinquante avions tournoyant très bas dans la lumière des fusées et dont on distinguait parfois un fuselage, une aile ou le stabilisateur, augmenté encore par la reprise furibonde des moteurs qui vissaient vers l'altitude les appareils déchargés de leurs lourds et dangereux paquets, le fracas des explosions déchirantes et sèches comme plusieurs salves de canons lourds, la pétarade incessante d'abord puis atténuée rapidement de la DCA, tout cela formait un décor sonore dont aucun film ne peut donner une impression fidèle : les tympans des auditeurs éclateraient. Il faut être en plein air pour supporter ces bruits de foudre, de volcan en éruption, de cataclysme. Non ! Nul ne peut oublier ces sifflements rapides et cette espèce de chuintement des ailettes se vissant dans l'air, intraduisibles même en onomatopées, ni l'entrée de la bombe dans le sol, accompagnée d'une brève secousse et d'un lourd halètement analogue à l'échappement de grosses motos au repos.
Et l'on se dit : "Celle-là est encore loin, celle-là aussi. Oh ! en voilà deux, trois, quatre ! Ca se rapproche ! Oh ! Celle-là c'est la mienne ! Qu'elle est proche !" En effet le point central de l'entonnoir était à quatre mètres de mes pieds. Ce n'était heureusement qu'une deux cent cinquante kilos !!"
Et ce sont alors des déflagrations si fortes que le tympan ne vibre plus, que l'on est secoué comme salade en panier, sans savoir exactement si c'est le corps qui s'ébroue d'instinct ou les commotions transmises par le sol qui déchaînent un tel branle. Aveuglé par la poussière et la fumée des explosifs, saupoudré et même recouvert de terre, de branches d'arbres, de moellons peu considérables, de morceaux de bois de charpente, haletant, les dents serrés, les reins endoloris, la tête ensanglantée et avec une sale brûlure au pied droit, occasionnée par un éclat pervers, venu d'on ne sait où, mais respirant encore, et vivant, je me dégage péniblement de la gangue de terre où je suis enseveli sous dix ou quinze centimètres d'argile pour me serrer davantage vers la toute petite murette protectrice, mainteneuse d'un illusoire grillage et fortement défendue par des buissons de fusains et de rosiers grimpants sur lesquels il est impossible d'élargir son espace vital. Je profite de l'occasion pour jeter un coup d'oeil furtif sur les alentours, sans trop lever le tête, car l'air est sillonné dans tous les sens par des projectiles de nature diverse et dont la plupart sont mortels : recevoir un plâtras, un petit moellon ou un morceau de bâti descendant de quelques mètres de hauteur et en chute normale, selon les lois ordinaires de la pesanteur, est tout à fait supportable quoique désagréable.
Mais voir s'abattre sur vous une grande ombre longue et noire qu'on imagine être le poteau de la ligne électrique et qui est en réalité l'escalier de la villa voisine "Fil d'argent" et l'éviter de justesse, d'un coup de reins, d'un saut de carpe, c'est du sport ! Et encore je n'ai pas tout à fait réussi à cause de ces inflexibles rosiers et fusains et j'ai eu la fesse droite, faiblement charnue - par la grâce d'Hitler - passablement aplatie mais sans luxation ni fracture. Un bleu de plus dans la série générale ne compte guère. C'est curieux quand même ; dans le vacarme général, ces grands machins tombent silencieusement sur vous avec un bruit sourd aussitôt évanoui. Il n'en va pas de même des éclats de bombe qui, selon leur forme et leur volume pouvant dépasser la superficie d'une assiette à soupe, sifflent dans l'air qu'ils déchirent à une incroyable vitesse, sectionnant les branches d'arbres, s'empêtrant dans les treillis, ricochant sur les pierres ou s'arrêtant pile avec un bruit mat sur les murs.
Une autre fois, comme un avion semblait me survoler de quelques mètres à peine tant le ronflement des moteurs se faisait fort, j'ai eu la curiosité d'en saisir la silhouette dans cette incroyable atmosphère épaisse de fumées et de poussière, éclairées d'en haut par les fusées. Qui n'a pas contemplé ce spectacle en plein air et en pleine nuit lors d'un bombardement massif, ne peut réaliser l'image. Quelquefois l'on voit en vitrine des librairies des cartes postales représentant des couchers de soleil aux teintes exagérées et des éclairages trop nettement contrastés, et l'on se dit : " Faut-il que les gens aient mauvais goût pour acheter ces horreurs de chromos ?" Et pourtant, que de fois soit au crépuscule du matin soit à celui du soir, généralement avant les arrivages de pluie, n'avons-nous pas vu des soleils étrangers et des teintes si vives qu'elles offusqueraient les regards d'un esthète mais non pas ceux d'un observateur qui est là pour voir, pour enregistrer et non pour porter des jugements plus ou moins subjectifs. Inutile d'ajouter que je n'ai pas aperçu l'avion et comme les chuintements des bombes n'étaient pas rapprochés, je me suis relevé pendant quelques instants, juste à temps pour voir s'élever en poussière dans un vaste éventail gris cendre, vaguement coloré par les luminosités du bombardement, la maison de mon voisin monsieur Théodore.
C'est formidable comme la pensée va vite dans des moments graves. Ce sont "les chevaux de la pensée" comme disaient les anciens, chevaux emballés que nul ne peut freiner. L'on est saisi par des intentions nettes et des volontés folle, par des désirs de sacrifice et par l'instinct de conservation. Oui, l'on se dit : "Les pauvres amis ! Pourvu qu'ils ne soient pas dans leur maison. Il faut aller voir ! Allons-y tout de suite. Attention, en voilà encore d'autres. Couche-toi vite, nom d'un chien ! ou tu ne verras plus rien du tout" ; et en effet, ça recommençait dur et ferme ni trop loin, ni trop près. Le mauvais moment était passé pour moi mais pas encore pour tous. Il était environ quatre heures trente, la distribution durait depuis vingt minutes. Le bruit des explosions diminuait, le formidable vrombissement des avions qui, chargement largué, avaient repris de l'altitude et s'éloignaient vers le sud-ouest s'atténuait. La DCA ne tirait plus depuis longtemps (mettons quinze minutes), tous les équipages des batteries s'étant réfugiés dans leurs blockhaus ; les fusées étaient consumées et ce fut de nouveau la nuit, la nuit sombre, fugitivement éclairée par endroit par les incendies déclarés dans la ville, la nuit rendue plus noire encore par l'épais nuage de poussière et de fumées épandu sur la cité, la nuit silencieuse d'où tout danger semblait exclu désormais.
Extrait du livre {I}Croix sur Royan{I} du pasteur Besançon.